Coopération ou néocolonialisme ?
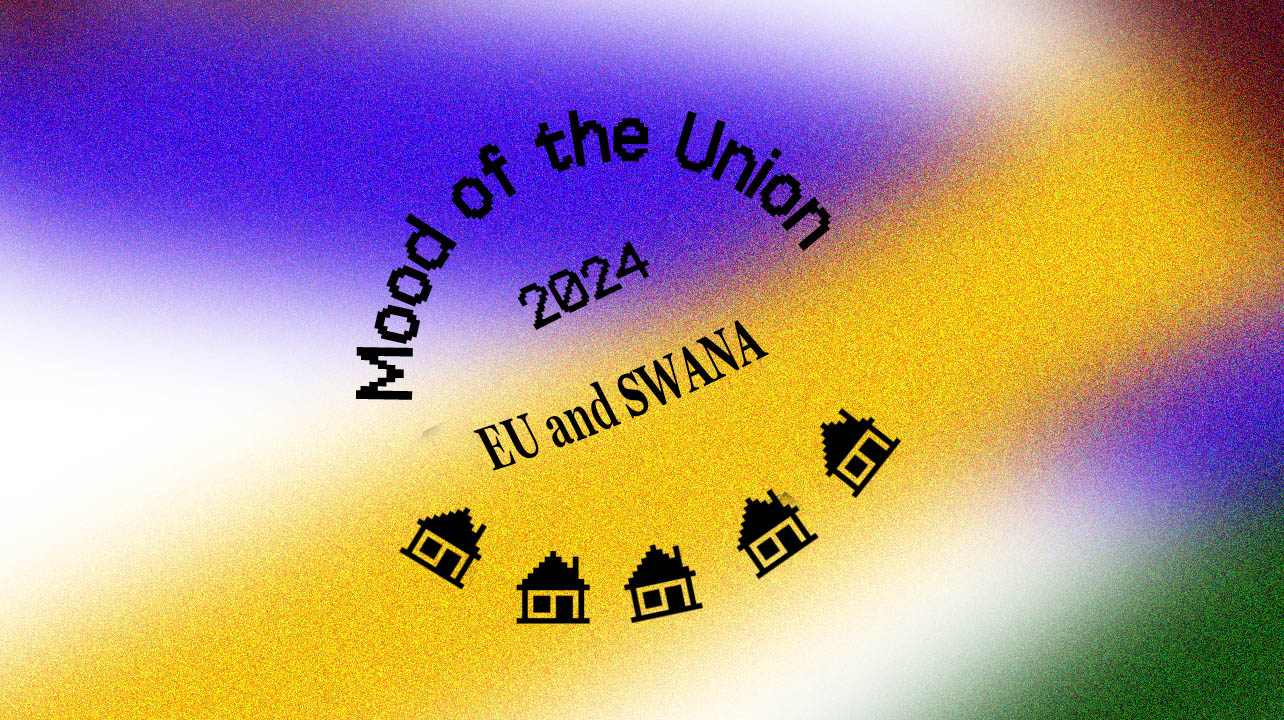
Ces dernières années, l’Union européenne (UE) a consolidé sa position en tant qu’acteur mondial, stimulée par des défis aigus tels que la pandémie de COVID-19 et le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine. Ces crises ont entraîné une réévaluation de la politique étrangère de l’UE. Ce faisant, la distinction entre les sphères politiques nationales et internationales s’est estompée, illustrant la façon dont les élections et les politiques nationales peuvent avoir des effets considérables sur la dynamique mondiale.
Un domaine central d’interconnexion est l’approche de l’UE en matière de migration, qui est essentielle à sa politique étrangère, en particulier depuis la « crise des réfugiés » de 2015. Plus de 2,39 millions de migrants ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l’Europe depuis lors, ce qui a incité les politiques à se concentrer sur la gestion des migrations, souvent qualifiée de « gestion », impliquant principalement les États méditerranéens du sud non membres de l’UE et de l’UE.
Le discours sur l’immigration a pris de l’ampleur, et une enquête du Conseil européen des relations étrangères de janvier 2024 indique que l’immigration est un sujet de préoccupation important au sein de l’UE. L’extrême droite a capitalisé sur cette question, conduisant les partis traditionnels à travers l’Europe à changer leurs positions sur l’immigration pour contrer ce qui est devenu un sérieux défi électoral.
Les partis d’extrême droite et les partis d’opposition sont en train de s’attaquer à la question de l’immigration.
La Commission européenne a publié un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces accords.
Syrie
La guerre en Syrie est au cœur de la politique étrangère de l’UE de l’Union européenne depuis une dizaine d’années. La guerre a éclaté en 2011 après que le gouvernement a réprimé des manifestations pacifiques en faveur de la démocratie, fait plus d’un demi-million de morts et déplacé environ la moitié de la population. Plus d’une décennie plus tard, alors qu’une grande partie du territoire a été reconquise par les forces gouvernementales syriennes soutenues par des alliés russes et iraniens, le conflit persiste avec pas de fin en vue.
Aujourd’hui, la politique syrienne de l’UE continue d’être guidée par la Stratégie sur la Syrie, un document adopté par le Conseil en avril 2017. Sur le plan politique, cette stratégie souligne la position de l’UE contre la normalisation des relations avec le régime syrien et son engagement à maintenir les sanctions. Sur le plan humanitaire, elle souligne l’engagement continu de l’UE en Syrie. L’UE et ses États membres continuent d’être le plus grand donateur pour la Syrie, ayant contribué à plus de 30 milliards d’euros d’aide humanitaire et économique depuis le début de la guerre.
Les sanctions de l’UE sanctions visent les personnes et les entités liées à des activités illicites et à la répression violente du peuple syrien. Visant à réduire les ressources financières du régime et à faire pression sur Assad pour qu’il entreprenne des réformes politiques, les sanctions n’ont pas encore produit les effets escomptés et leur efficacité ainsi que leur impact sur la population syrienne restent un sujet de débat au sein de l’UE. Malgré les sanctions, l’UE est le premier partenaire commercial de la Syrie.
Depuis le début de la guerre guerre en 2011, plus de 14 millions de Syriens ont été déplacés, dont plus de 7,2 millions sont actuellement déplacés à l’intérieur du pays. Les pays voisins tels que la Turquie, le Liban, la Jordanie, l’Irak et l’Égypte accueillent collectivement environ 5,5 millions de réfugiés syriens, l’Allemagne étant le plus grand pays de destination de l’UE, avec plus de 850 000 personnes.
L’Allemagne est le plus grand pays de destination de l’UE, avec plus de 850 000 personnes.
Aujourd’hui dans sa treizième année, la guerre en Syrie a été exacerbée par l’effondrement économique, la perte des moyens de subsistance, la persistance sécheresse, et le tremblement de terre dévastateur de 2023 séisme, qui a porté la crise humanitaire à des niveaux sans précédent. Sur les 18 millions de personnes que compte la Syrie, 16,7 millions sont dans le besoin d’aide humanitaire ; si l’on inclut la diaspora, le nombre dépasse 30 millions. Actuellement, plus de 80 % des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté international, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 10 % signalés avant le début du conflit. En 2024, significant cuts in funding by the World Food Programme has seen a 80% decrease in the number of Syrians receiving food assistance, severely affecting child nutrition and worsening the situation yet further.
Malgré la situation humanitaire actuelle, plusieurs pays qui accueillent des réfugiés et des demandeurs d’asile syriens – notamment le Liban, le Danemark et la Turquie – ont tenté de les renvoyer en Syrie. Il s’agit d’une décision politique qui a été examinée de près par les organisations de la société civile. Un rapport de février 2024 OHCHR a mis en lumière les souffrances des personnes renvoyées, dont la situation « soulève de sérieuses questions quant à l’engagement des États en faveur d’une procédure régulière et du non-refoulement », selon les termes de Volker Türk, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.
Les personnes renvoyées en Syrie ont été victimes d’actes de torture et de mauvais traitements.
Mais face aux nombreux défis des pays d’accueil, des centaines de milliers de réfugiés syriens ayant fui la guerre sont retournés chez eux, malgré la sombre situation sécuritaire et humanitaire qui les attend.
Türkiye
Touchée par les mêmes tremblements de terre dévastateurs séismes en 2023, la Turquie endure une décennie de récession. L’inflation officielle a atteint presque 60 %, plaçant le pays au cinquième rang mondial, selon le Fonds monétaire international (FMI). Alors que la livre turque s’effondrait contre l’euro et le dollar, les détracteurs du président Recep Tayyip Erdogan anticipaient que les difficultés économiques et le mécontentement de la population conduiraient à un changement de gouvernement lors des élections présidentielles qui se tiendront en mai 2023. Pourtant, Erdogan s’est assuré un nouveau mandat de cinq ans, poursuivant son règne de deux décennies.
Les élections locales de 2024 ont peint une image différente, cependant, avec le principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), obtenant des victoires significatives dans les grandes villes comme Istanbul, Ankara et Izmir, et capturant les villes traditionnellement fortes de l’AKP le long de la mer Noire et de l’Anatolie. Ces résultats ont insufflé un regain d’espoir et de motivation parmi les partisans de l’opposition, qui avaient été démoralisés après des années de défaites.
Les partisans de l’AKP ont remporté des victoires importantes dans des villes comme Istanbul, Ankara et Izmir, et se sont emparés de villes traditionnellement fortes de l’AKP le long de la mer Noire et en Anatolie.
Paysage : la Turquie est un pays de l’Europe de l’Est.
notre traduction
Malgré les relations tendues, un consensus émerge entre la Turquie et l’UE sur la nécessité de redéfinir le cadre de leur coopération. Alors que les négociations d’adhésion sont toujours au point mort, la migration est un domaine où la collaboration se poursuit. En mars 2016, l’UE et la Turquie ont signé un accord visant à freiner la « migration irrégulière » vers l’Europe. Cependant, tout en accueillant la plus grande population de réfugiés au monde, la Turquie a faced  ;Les déportations sont devenues un sujet de controverse, en particulier pendant la période où les réfugiés ont été relocalisés de force dans les zones sous son contrôle en Syrie ://apnews.com/article/turkey-presidential-parliamentary-election-syrian-refugees-d8ddc022f5285cb2440df58a206b4bfc » target= »_blank » rel= »noreferrer noopener »>périodes électorales. En mars 2024, Human Rights Watch a rapporté que ‘Bien que la Turquie ait soutenu par le passé que tous les retours étaient volontaires, les forces turques ont, depuis au moins 2017, arrêté, détenu et expulsé sommairement des milliers de réfugiés syriens, les contraignant souvent à signer des formulaires de retour « volontaire » et les forçant à traverser dans le nord de la Syrie.’
La Turquie n’est pas en mesure d’expulser les réfugiés syriens.
Égypte
Le paysage politique de l’Égypte a radicalement changé depuis le Printemps arabe, notamment vers la militarisation sous le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a remplacé Mohamed Morsi, démocratiquement élu mais de plus en plus anti-laïque, via un coup d’État militaire en 2013. Les récentes élections fin 2023 ont vu la réélection de Sisi au milieu accusations de manipulations électorales. Ces bouleversements se sont déroulés parallèlement à de graves défis économiques, tels qu’une inflation record en 2023, des projets d’infrastructure irréalistement ambitieux et la dévaluation de la livre égyptienne, qui a plongé de larges pans de la population dans la détresse économique.
Conscients de la crise économique égyptienne et des conflits régionaux en cours, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et plusieurs dirigeants de l’UE se sont rendus au Caire en mars 2024 pour signer une déclaration commune pour un partenariat stratégique entre l’UE et l’Égypte. Cet accord comprend un programme d’aide de 7,4 milliards d’euros destiné à soutenir l’économie égyptienne et à gérer les migrations vers l’Europe, ainsi qu’une coopération dans le domaine des initiatives énergétiques à faible émission de carbone et des échanges dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la jeunesse.
Une composante majeure de ce partenariat concerne les mesures de « gestion des migrations ». Cette collaboration a suscité des inquiétudes quant au traitement des migrants et des réfugiés, qui sont environ 480 000 en Égypte. L’absence d’un cadre juridique pour l’asile, la dépendance du pays à l’égard d’un HCR débordé et l’hostilité croissante à l’égard des migrants d’Afrique subsaharienne ont contribué à rendre la situation des réfugiés de plus en plus précaire.
Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
Tunisie
La Tunisie, autrefois saluée comme le balise du printemps arabe, fait face à des temps politiques incertains avec les prochaines élections présidentielles qui doivent encore être programmées pour la fin de 2024. Le président sortant Kais Saied devrait se représenter. Son mandat, après sa prise de pouvoir controversée en juillet 2021, a vu le démantèlement systématique des institutions démocratiques, conduisant le pays vers l’autocratie dans un contexte de répression croissante contre les journalistes, les opposants politiques et les militants de la société civile.
Les élections présidentielles de fin 2024 sont prévues pour la fin de l’année.
L’accord a été largement critiqué par la société civile, pour diverses raisons. Tout d’abord, elle a coïncidé avec une augmentation de la répression en Tunisie même, le gouvernement étant accusé de diverses violations des droits de l’homme, y compris à l’encontre des migrants. L’accent mis par l’UE sur le contrôle des frontières a été considéré comme complice de ces abus, étant donné qu’un financement substantiel de l’UE a été dirigé vers les forces de sécurité impliquées dans ces abus. Cela a à son tour soulevé des inquiétudes quant à l’engagement de l’UE envers les normes en matière de droits de l’homme.
Les relations se sont encore détériorées après que la Tunisie a restitué l’argent de l’UE, dans un contexte d’escalade des tensions entre Bruxelles et Tunis au sujet de l’accord controversé sur les migrants. La Commission a confirmé que la Tunisie avait restitué 60 millions d’euros en septembre 2023. Cette décision a porté un coup sérieux à l’accord sur les migrants signé par la Commission européenne avec la Tunisie en juillet, qui proposait de l’argent en échange d’une aide pour endiguer les flux de migrants traversant la mer Méditerranée vers l’Europe. L’UE prévoit de fournir jusqu’à 164,5 millions d’euros sur trois ans aux forces de sécurité tunisiennes. Avec une part importante allouée à la sécurité et à la gestion des frontières, les implications en matière de droits de l’homme restent critiques.
Alors que l’engagement de l’UE avec la Tunisie s’est concentré sur la migration, il s’étend également à la diversification énergétique, en particulier dans le cadre de REPowerEU initiative, pour passer d’une dépendance au gaz russe et à d’autres combustibles fossiles à des sources d’énergie durables telles que l’hydrogène. La Tunisie se positionne comme un partenaire crucial dans cette transformation, prévoyant de lancer des exportations d’hydrogène renouvelable vers l’Europe via des pipelines dès 2030. Le pays vise à livrer 6 millions de tonnes par an d’ici 2050, ce qui le place aux côtés du Maroc, de l’Algérie et de l’Égypte en tant que fournisseurs clés potentiels d’hydrogène pour l’UE.
Cependant, ces plans ambitieux ont suscité une vive controverse. Les critiques, notamment de Corporate Europe Observatory, ont qualifié la stratégie d' »accaparement néocolonial des ressources ». Ils s’interrogent sur l’opportunité d’utiliser les ressources renouvelables limitées de l’Afrique du Nord principalement au profit de l’Europe. La faisabilité de l’augmentation de la production d’hydrogène pour atteindre ces objectifs fait également l’objet d’un examen minutieux. Des inquiétudes ont été exprimées quant aux coûts élevés et à la faible efficacité énergétique de la production d’hydrogène pour l’exportation, qui pourrait négliger les besoins environnementaux locaux essentiels, sapant ainsi l’agenda de la durabilité régionale.
Liban
Le Liban a été mis à rude épreuve par de multiples crises. La guerre qui fait rage depuis 2011 dans la Syrie voisine a poussé environ 1,5 million de réfugiés au Liban ; pour une population totale de 6 millions d’habitants, cela donne au pays le taux de réfugiés par habitant le plus élevé au niveau mondial. Cette situation a été exacerbée par une crise économique dévastatrice qui a débuté en 2019 et a été aggravée par la pandémie de COVID-19, plongeant environ 80% des Libanais population dans la pauvreté, 36% d’entre eux vivant sous le seuil d’extrême pauvreté.
La crise s’est aggravée le 4 août 2020, avec l’explosion du port de Beyrouth, qui a fait 218 morts et causé d’importants dégâts matériels estimés jusqu’à 4,6 milliards de dollars. La catastrophe a touché plus de la moitié des centres de soins de santé de la capitale et 56 % de ses entreprises.
La gouvernance du Liban est minée par la corruption et l’inefficacité, se classant 149 sur 180 sur l’indice de corruption de Transparency International. Son système politique, basé sur le partage du pouvoir entre divers groupes sectaires, n’a pas réussi à fonctionner efficacement, aucun budget n’ayant été adopté depuis plus d’une décennie et les allégations d’achat de votes et d’ingérence dans les élections étant fréquentes. L’impasse politique permanente a laissé le Liban sans président depuis fin 2022 et le pays fonctionne actuellement sous un gouvernement intérimaire aux pouvoirs limités.
L’impasse politique permanente a laissé le Liban sans président depuis fin 2022 et le pays fonctionne actuellement sous un gouvernement intérimaire aux pouvoirs limités.
La population réfugiée au Liban est confrontée à une situation humanitaire désastreuse. Les réfugiés, dont environ 815 000 individus enregistrés auprès des Nations Unies, luttent contre des conditions de vie difficiles caractérisées par des abris inadéquats, un accès limité aux soins de santé et une insécurité alimentaire galopante. Accablé par les crises économiques et politiques, le gouvernement libanais halté l’enregistrement des nouveaux réfugiés en 2015, compliquant ainsi les efforts de soutien.
Mais les chiffres devraient augmenter à mesure que davantage de demandeurs d’asile arrivent de Palestine et d’autres guerres en cours dans la région.
Selon Human Rights Watch, « les décisions récentes de nombreux États membres de l’UE de suspendre le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui fournit une assistance à 250 000 Palestiniens au Liban – dont 80 % vivent déjà sous le seuil de pauvreté – ont mis encore plus à rude épreuve la population réfugiée du Liban.’ Le Liban a également reçu seulement 27% du financement mondial requis pour sa réponse aux réfugiés syriens au cours de l’année précédente, ce qui a eu un impact significatif sur la capacité à maintenir les services de base pour ces populations déplacées.
En réponse à ces crises, l’UE a conclu un accord au début du mois de mai 2024 pour fournir au Liban 1 milliard d’euros sur trois ans. Cette aide vise à stabiliser l’économie libanaise et à contrôler le nombre croissant de réfugiés se dirigeant vers l’Europe. Cependant, cet accord a suscité des inquiétudes quant à l’approche de l’UE en matière de gestion des migrations, qui privilégie souvent le contrôle des frontières au détriment de la protection des droits de l’homme.
Le syndicat à la croisée des chemins
Aujourd’hui, l’Union européenne se trouve à la croisée des chemins en matière de politique étrangère. Les partenariats de l’UE avec les pays méditerranéens non membres de l’UE, bien que complexes et à multiples facettes, continuent d’être influencés par une mentalité néocoloniale historique qui donne la priorité aux intérêts stratégiques plutôt qu’aux partenariats équitables. Ce moment critique place l’UE devant un choix difficile : poursuivre ses tactiques actuelles de commerce unilatéral et d’extraction des ressources ou s’orienter vers des relations de coopération authentique qui respectent la souveraineté et la progression économique de ces nations.
Toutefois, le potentiel d’un parlement plus à droite après l’élection pose un risque substantiel d’approfondir ces pratiques inéquitables, perpétuant l’héritage de l’exploitation sous des formes modernes. L’approbation récente du Pacte européen sur les migrations qui encourage l’utilisation de technologies de surveillance et de contrôle, suggère également que les politiques d’externalisation vont s’intensifier, conduisant à une approche moralement compromise et stratégiquement erronée.



